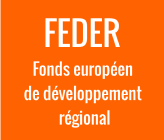Contrebande. Une cartographie de la bande dessinée alternative francophone
[novembre 2025]
Recension de l'ouvrage de Morvandiau, Contrebande. Une cartographie de la bande dessinée alternative, Rennes, Les Éditions du Commun, 2024.
Ouvrage sélectionné au sein du prix SoBD/Neuvième Art 2024
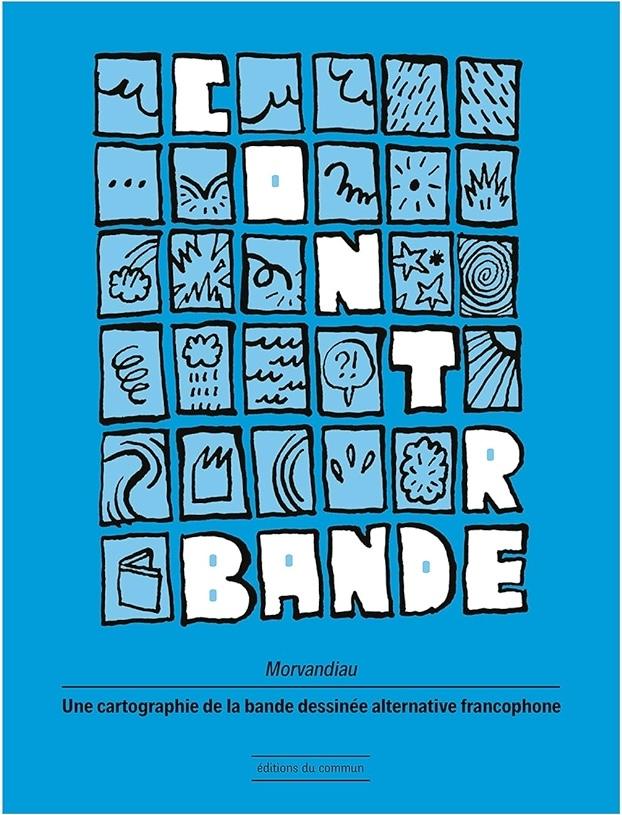
Trente-cinq ans après son apparition, une étude synthétique sur les évolutions de l’édition alternative de bande dessinée francophone manquait cruellement à l’appel. L’émergence de ces éditeurs dits indépendants a radicalement bouleversé l’ensemble du champ éditorial de la bande dessinée. Pourtant, en dehors de la production critique provenant des ces éditeurs, il n’existait pratiquement jusque-là que des études monographiques sur L’Association (Groupe Acme, 2011 et Caraco, 2025) et un livre d’entretiens focalisé sur la seconde génération d’éditeurs alternatifs (Hojlo, 2023). Version remaniée d’une thèse de doctorat (Morvandiau, 2023), la publication de Contrebande par les éditions du Commun s’impose donc comme un premier ouvrage de référence sur le sujet.
Ambitieux, l’auteur-chercheur Morvandiau propose une approche sociologique de l’édition alternative dans la première partie de son étude, puis une analyse esthétique de certaines de ses publications dans sa seconde partie. Sous-titré Une cartographie de la bande dessinée alternative francophone, le livre propose littéralement trois cartes détachables des lieux emblématiques de la contrebande et de ses éditeurs que Morvandiau sépare en deux générations, celle qui a défriché le terrain dans les années 90 et la seconde apparue dans les années 2000 et 2010. La première est surtout composée d’auteurs-éditeurs ayant décidés de concevoir en autodidactes leur propre outil de production pour palier au rejet que leur travail suscitait chez les maisons d’édition déjà établie à la fin des années 80. Émergeant dans des conditions de légitimité plus favorables, la seconde génération « n’affiche pas une radicalité artistique aussi nette ni exclusivement dédiée au 9e art » (p. 42). Plus loin, Morvandiau constate un passage de « la critique artiste » focalisée sur l’esthétique à « la critique sociale et la question de l’égalité dans les rapports sociaux », allant de pair avec une féminisation du milieu et une revendication d’amélioration du statut des auteurices. Tout l’enjeu pour lui est de parvenir à saisir les mutations de la contrebande de 1990 jusqu’à aujourd’hui. Constatons au passage que sa cartographie omet des événements et des structures pourtant importantes dans la construction d’un discours critique sur la contrebande, en particulier le SoBD et les éditions Adverse.
Le choix de désigner ces différents acteurices de l’édition alternative de bande dessinée par le terme de contrebande permet d’identifier d’emblée la stratégie de « se confronter au système commercial de la chaîne du livre » (p.13) contrairement à la sphère parallèle du fanzinat dont beaucoup de membres de la contrebande sont issus. Morvandiau remarque que cette confrontation entraîne une « politisation des pratiques » de la contrebande, dans la lignée des mouvements contre-culturels des années 60 et 70. Comme le résume Jean-Christophe Menu, co-fondateur de L’Association : « l’Underground se positionne en dehors, l’Alternatif se positionne contre » (p. 21), sous-entendu contre le champ éditorial de la bande dessinée dominé par des logiques commerciales au détriment de l’ambition artistique et d’une pratique de l’édition « proche d’une forme d’artisanat » (p.20).
Cette stratégie engendre plusieurs points de tensions et de contradictions que le livre soulève. Comment faire face à « une labellisation de « l’indé » par l’industrie » (p.44) et inversement, comment empêcher une industrialisation de l’alternatif ? Morvandiau remarque que « la contrebande doit couramment affronter le soupçon selon lequel sa démarche alternative ne serait qu’un élément de marketing » (p.151). À ce titre, il souligne les différences parfois importantes entre les éditeurs de la contrebande. Le chercheur oppose un pôle radical représenté par Le Dernier Cri, éditeur de graphzine volontairement resté en marge de la contrebande, à un pôle plus pragmatique incarné par Serge Ewenczyk, fondateur de çà et là qui est l’un des rares contrebandiers à avoir suivi une formation commerciale. Au cours de la lecture, on peut en venir à interroger la pertinence d’analyser « la » contrebande comme une seule entité unie et cohérente dans le temps. Un travail de délimitation plus strict et explicite de cette contrebande, ou peut-être l’aveu qu’il en existe plusieurs aurait permis d’affiner l’analyse. Par exemple, une opposition comme celle de Kevin le Bruchec qui distingue dans sa thèse en cours de rédaction deux groupes d’alternatifs, « la frange » et « la marge » selon leur niveau d’intégration dans l’économie du livre, permet de mieux saisir les ambiguïtés de la notion de bande dessinée indépendante.
Morvandiau constate que « la radicalité affichée – refus de solliciter des subventions publiques, d’imprimer des codes-barres sur les livres ou de recourir au pilon – a souvent été nuancée dans la durée » (p. 43). Mais il semble éviter d’aborder en détail les clivages internes à la contrebande, peut-être à cause de sa forte proximité avec certains éditeurs, comme ceux qui l’ont publié depuis les années 2000. Si l’auteur aborde brièvement en conclusion le caractère situé de sa démarche, force est de constater qu’il ne l’a pas suffisamment pris en compte en ignorant certains sujets qui fâchent. L’assagissement de la posture autrefois oppositionnelle de Jean-Christophe Menu vis-à-vis de l’édition dominante n’est par exemple pas évoquée, alors qu’elle a suscité des réactions virulentes de la part d’autres acteurices de la contrebande, comme dans la revue Pré Carré (Dominique, 2019). De même, la controverse houleuse parmi les contrebandiers autour de la démarche éditoriale de La Cinquième Couche reste éludée.
De manière générale, Morvandiau insiste davantage sur la convergence des éditeurs de la contrebande, qui se sont réunis en 2014 au sein du Syndicat des Éditeurs Alternatifs (SEA) plutôt que sur d’éventuelles divergences d’objectifs ou d’intérêts. Par exemple, l’éventuelle tentation pour certains éditeurs alternatifs de se fondre dans le modèle de la bestsellerisation suite aux premiers succès éditoriaux de la contrebande n’est pas interrogée, sauf à travers l’évocation de l’œuvre critique d’Ilan Manouach. Le chercheur préfère amener sa réflexion vers une typologie des contrebandiers fondée selon le modèle de la sociologue Mary Douglas. Celle-ci a pour mérite de discerner deux modes de fonctionnement des maisons d’édition : l’un collectif, tandis que d’autres structures restent menées par la forte personnalité d’un seul éditeur. Cette catégorisation apporte des facteurs explicatifs aux crises internes de certaines structures et aux difficultés rencontrées pour faire valoir leurs intérêts auprès des institutions, face aux poids lourds du Syndicat National de l’Édition (SNE). Mais l’analyse typologique aurait pu être prolongée en catégorisant en détails les positions et les oppositions socio-esthétiques au sein de la contrebande, par exemple avec la notion de champ littéraire de Pierre Bourdieu et les catégories qu’elle implique. Celle-ci permettrait de ne pas considérer comme acquise et univoque la solidarité existante entre les différentes structures alternatives, pour mieux relever leurs opérations de distinction et leurs désaccords idéologiques.
Qu’à cela ne tienne, l’étude ne perd jamais de vue l’essentiel, à savoir les conditions matérielles d’existence et de reproduction de la contrebande, en consacrant tout un chapitre sur son rapport à la chaîne du livre. Morvandiau analyse la lente et difficile professionnalisation des différentes maisons d’édition émergeant dans les années 90, au prix d’une abnégation caractéristique des acteurices de la contrebande. Lorsque Aurélia Badoc des Requins Marteaux admet un fonctionnement « usant un peu les gens jusqu’à la corde et en en prenant d’autres après » (p. 116), on devine sans peine les contradictions et souffrances qu’entraînent ces économies fragiles. La comparaison des différents parcours pointe le modèle récurrent de la revue autodiffusée qui précède le passage à l’édition selon un fonctionnement associatif (62 % des structures sont régies par la loi de 1901). Mais Morvandiau s’attarde aussi avec soin sur des parcours plus singuliers comme celui de Benoit Jacques Books. Par ailleurs, sa réflexion sur l’implantation spatiale des maisons d’édition lui permet d’opposer le parcours des structures parisiennes qui captent davantage de visibilité et de reconnaissance symbolique, tandis que celles implantées dans d’autres villes tentent de s’appuyer sur les atouts spécifiques à leurs régions. Même si là encore, Morvandiau ne relève pas assez comment les liens privilégiés des structures éditoriales parisiennes avec le diffuseur-distributeur Le Comptoir des Indépendants et leur meilleure visibilité médiatique pouvait désavantager d’autres maisons d’édition alternatives, telle que feu ego comme x.
La partie du livre qui éclaire de la manière la plus inédite l’autonomisation de la contrebande se révèle justement celle consacrée au Comptoir des Indépendants, créé dans la foulée de la diffusion ambitieuse de Comix 2000. Les propos rapportés dans l’ouvrage montrent comment la structure de diffusion-distribution devient peu à peu le cheval de Troie de la contrebande pour élargir son implantation en librairie, sans éluder les difficultés qui ont amené à sa fermeture en 2011. Cette date symbolique qui correspond aussi à la crise de L’Association aurait pu amener à déterminer une éventuelle rupture chronologique dans la montée en puissance des structures alternatives. Néanmoins Morvandiau décrit bien le processus de récupération des acquis de la contrebande par l’édition dominante, dans un contexte de surproduction qui a entraîné des crises économiques dans la plupart des structures alternatives au cours des années 2010. Il s’attarde sur l’exemple d’Actes Sud et sa démarche de rachat de plusieurs maisons d’édition comme Cambourakis. Et il souligne surtout les conséquences désastreuses de l’accélération du phénomène de concentration dans l’édition. À ce titre, difficile de ne pas penser à la mobilisation sociale d’ampleur qui est menée depuis quelques mois à l’encontre de la figure de Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Hachette depuis 2023.
Cette première partie du livre s’adresse aussi bien aux néophytes qui ne connaissent pas l’histoire de la contrebande qu’à ceux qui suivent la production alternative depuis longtemps. En sept ans de thèse, Morvandiau a eu autant le temps d’étudier les épisodes déjà commentés de ces aventures éditoriales que ceux plus méconnus, comme les tentatives ruineuses et éphémères mais instructives des revues Jade (6 pieds sous terres) et Ferraille (Les Requins Marteaux) de s’implanter en kiosque. Ce portrait de famille de la contrebande permet de bien comprendre comment, malgré les intempéries, la plupart de ses structures continuent aujourd’hui d’exister. Malgré l’opération de récupération des éditeurs dominants, la contrebande propose toujours aux auteurices une plus grande liberté artistique qu’ailleurs, au prix de faibles avances sur droit. Paradoxalement, elle s’est aussi maintenue en suivant l’axiome de ne pas trop grandir, le SEA stipulant que la limite se situe à 40 titres par an publiés pour chaque structure.
La seconde partie, consacrée aux apports esthétiques de la contrebande, s’adresse moins aux connaisseurs qu’aux lecteurices qui voudraient s’orienter dans la production pléthorique de la contrebande, et mieux connaître ses œuvres marquantes comme ses plus méconnues. Elle étudie en effet des tendances déjà largement commentées ailleurs. Morvandiau passe d’abord en revue les best-sellers de la contrebande, notant que la plupart d’entre eux se caractérisent par un ancrage dans le réel. Il analyse les tendances fortes qu’elle a suscité comme la féminisation du champ et la mise à bas des stéréotypes de genre, le renouvellement du registre parodique, la prégnance d’une bande dessinée réflexive et le décloisonnement des arts. D’Alex Barbier à Yvan Alagbé en passant par Dominique Goblet et Rachel Deville, l’auteur effectue également un tour d’horizon des auteurices méconnus du public malgré leur forte reconnaissance symbolique. Si cette seconde partie peut donner l’impression que deux livres ont été réunis en un seul, cet assemblage se révèle pertinent pour aboutir à un ouvrage de synthèse. Notons enfin un choix d’iconographie souvent juste qui s’insère bien dans le flux de la réflexion.
Bibliographie
Pierre Bourdieu, Les règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Le Seuil, 1992.
Morvandiau, L'art de la contrebande ? Tentative de cartographie des pratiques de la bande dessinée alternative contemporaine, thèse de doctorat soutenue en 2023.
Groupe Acme, L’Association, une utopie éditoriale et esthétique, Les Impressions Nouvelles, 2011.
Benjamin Caraco, Une histoire de L’Association, Presses Universitaires François-Rabelais, collection Iconotextes, 2025.
Claude Dominique, « Par le Menu », Pré Carré,n° 13, 2019. Voir lien : http://www.le-terrier.net/pre_carre/numero13/parlemenu.htm
Frédéric Hojlo, Second Souffle, Flblb, 2023.
Kevin Le Bruchec, Les éditeurs alternatifs de bande dessinée : permanences et spécificités d'un champ éditorial contemporain, thèse en cours : https://theses.fr/s161678
Kevin Le Bruchec, « I. Une certaine idée de la bande dessinée : Tentative de cartographie de l’espace des éditeurs alternatifs », in Pascal Robert (dir.), La fabrique de la bande dessinée Perspectives sociologiques et sociosémiotique sur la bande dessinée, Hermann, 2023, p.15-30.
Pour aller plus loin
Entretien avec un contrebandier, Daniel Pellegrino des éditions Atrabile