
Lauréat du prix SoBD/Neuvième Art 2025. La bande dessinée en Asie orientale. Un art en mouvement
Lauréat du prix SoBD/Neuvième Art 2025.
Recension de Julien Bouvard, Norbert Danysz, Marie Laureillard (dir.), La Bande dessinée en Asie orientale. Un art en mouvement, Paris, Hémisphères, 2025, coll. "Asie en perspective", 243 pages. ISBN 9782377012121.
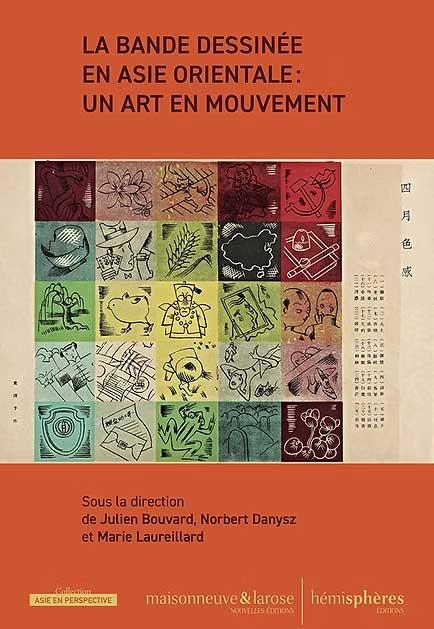
Julien Bouvard, Norbert Danysz, Marie Laureillard (dir.), La Bande dessinée en Asie orientale. Un art en mouvement, Paris, Hémisphères, 2025.
Si la bande dessinée japonaise a fait l’objet de plusieurs ouvrages spécialisés en langue française, de quantité d’expositions, le reste de la bande dessinée venue d’Asie orientale reste mal connu. C’est tout l’intérêt de cet ouvrage collectif, issu de deux colloques organisés en 2021-2022, que de proposer une série d’éclairages visant à combler ces lacunes.
Paul Gravett avant proposé le terme de mangasia, pour pointer l’importance du complexe culturel japonais dans la structuration d’une culture graphique d’Asie orientale. Mais les contributions rassemblées dans cet ouvrage pointent la diversité des influences et des circulations. C’est particulièrement net lorsqu’on se penche sur l’histoire de la bande dessinée chinoise : « après l’accession au pouvoir du Parti communiste en 1949, le manhua chinois est jugé trop perméable aux influences étrangères (occidentales ou japonaises) et cède du terrain face au lianhuanhua, qui devient la forme de bande dessinée hégémonique de la propagande maoïste » (p. 15). La diversité des formes et des traditions conduit les autrices et auteurs de l’ouvrage à privilégier une approche ouverte de la bande dessinée, qui englobe quantité de récits conduits par la succession des images, au-delà de débats sémiotiques souvent assez vains.
C’est d’ailleurs l’approche constructiviste qui se montre, de mon point de vue, la plus convaincante dans cet ouvrage, lorsqu’elle envisage la bande dessinée en Asie orientale sous l’angle de leur matérialité et de leurs remédiations formelles. Comme il est d’usage dans ce type de publications collectives, les échelles d’analyse varient fortement, ce qui fait toute la richesse de l’ouvrage : certaines interventions portent sur une œuvre (Chu Kin-wai, Morita Naoko), ou sur un auteur (Freya Terryn), quand d’autres portent sur des phénomènes beaucoup plus larges, qu’il s’agisse de formes esthétiques (Xavier Hébert), de registres thématiques (Paul Narjoz-Delatour) ou de formes culturelles (Julien Bouvard, Deng Hao, Violette Bischoff). L’ouvrage est structuré en trois parties, mais l’absence de textes de cadrages pour chacune de ces parties rend cette construction relativement secondaire, au-delà de la cohérence des regroupements d’approches.
L’ouvrage est dense, et les approches, on l’a dit, variées. Chacun y trouvera donc son compte. Pour ma part, au-delà du grand intérêt de l’ouvrage dans l’ensemble, plusieurs des contributions m’ont semblé particulièrement précieuses – ce qui ne préjuge en rien de la valeur des autres contributions, mais reflète plutôt mes centres d’intérêt singuliers.
L’approche esthétique est le premier axe qui rassemble les contributions de cet ouvrage, aidé par une iconographie abondante. Marie Laureillard, dans son analyse d’une adaptation du Jin Ping Mei, célèbre roman érotique adapté et sérialisé dans la presse shanghaienne des années 1930-1940, se penche sur son esthétique singulière. Elle montre comment l’auteur, Cao Hanmei, s’adapte aux contraintes de la reproduction, en soulignant les contours et les silhouettes ; il privilégie l’épure et la lisibilité. Le style de Cao Hanmei est fait d’éclectisme et d’hybridité générique, empruntant aussi bien aux traditions picturales du dessin des fictions illustrées (xiuxiang xiaoshuo), tout en empruntant aussi des éléments clairement empruntés au langage de la bande dessinée occidentale. Aboutissement d’une dizaine d’années de recherches, Jin Ping Mei s’inscrit dans un « réalisme minutieux du quotidien ». Elle montre par ailleurs la manière dont la publication en feuilletons favorise une interaction dynamique avec le public. Le passage de la revue au livre accompagne une « évolution du mode illustratif vers le mode séquentiel » (p. 55). Mais la partie sans doute la plus fascinante de cet article réside dans l’analyse des metapictures, ces images enchâssées jouant sur la mise en abyme et l’autoréférentialité.
La question des spécificités stylistiques est au cœur des questionnements du livre. Xavier Hébert, notamment, poursuit ses travaux sur les généalogies stylistiques du manga moderne, à travers la production de Tezuka Osamu, en isolant en particulier les traits stylistiques des yeux des personnages, prolongeant ainsi des hypothèses déjà avancées dans le volume collectif Style(s) de la bande dessinée (Classiques Garnier, 2019), et pointant des « filiations étonnantes, souvent issues de champs extérieurs au manga » (p. 87). L’article est touffu, parfois déroutant par son approche panoramique, mais la richesse de son corpus en fait l’intérêt : illustration de romans, récits illustrés (e-monogatari), kamishibai, mangas de prêt (kashihon manga)… L’approche large de séries culturelles diversifiées et d’influences esthétiques nombreuses offre à cet article une ambition intéressante.
Le deuxième axe fort de cet ouvrage porte sur les formats éditoriaux et les matérialités de ces bandes d’Asie orientale. C’est notamment le cas de Julien Bouvard, qui signe dans ce volume un article particulièrement passionnant consacré à « La dimension matérielle du manga. À propos du format tankobon ». Prenant le contre-pied de la vision formaliste du manga ou d’une lecture strictement culturaliste, il montre l’intérêt d’une approche formelle consacrée à la bande dessinée japonaise s’inscrivant dans un tournant matériel des études sur la bande dessinée. Son approche lie à la fois analyse économique du secteur, compréhension des procédés de fabrication, des espaces de diffusion et des modes de lecture. Il montre comment l’unification du manga autour du format actuel du tankobon a pu être réalisé, et pointe notamment le rôle décisif du format shinso, un format de poche (10x18 cm) en apparence très éloigné de la bande dessinée, un format dédié aux essais sur la société, la politique et l’économie. Dans les années 1950, des expérimentations éditoriales voient ainsi des éditeurs publier des titres de manga en format de poche, à destination d’un lectorat adulte, notamment pour raconter le quotidien des salarymen japonais sous forme de récits en 4 cases (p. 100). Il faut cependant attendre les années 1960 pour voir le manga véritablement gagner le monde du livre, transformant au passage le travail de suivi éditorial.
Dans la suite de son article d’une grande richesse, Julien Bouvard analyse en détail « ce que le livre fait au manga » (p. 102) et aux mangakas, montrant notamment comment le tankobon multiplie les formes d’auctorialité et contribue à la légitimité culturelle du manga. Il montre également les effets narratifs de l’édition en tankobon, qui privilégie des formes narratives longues : le livre permet d’approfondir l’expérience de lecture, contrairement à la lecture fragmentée en périodique. Le nouveau standard éditorial conduit également les mangakas à « simplifier et aérer leurs mises en page » (p. 105), à multiplier les gros plans sur les visages, à privilégier les informations importantes dans le bas des pages, etc. Ainsi, le passage de la bande dessinée de la presse au livre s’est réalisé plus lentement au Japon qu’en France. Mais, surtout, la comparaison permet de montrer que « la mise en livre des bandes dessinées (…) a eu lieu à travers un format radicalement opposé (p. 109).
L’ouvrage, au-delà des analyses précises qu’il offre sur tel ou tel aspect de la bande dessinée en Asie orientale, insiste largement sur les circulations et transferts culturels. Par exemple, l’article de Violette Bischoff esquisse quelques pistes d’explication à la difficile implantation de la bande dessinée chinoise dans l’offre éditoriale française (même si l’argumentation eût assurément gagné à être resserrée).
Si cette question de la circulation des styles, des formes, et des transferts culturels traverse tout l’ouvrage, c’est sans doute dans l’article de Norbert Danysz qu’elle trouve sa formulation la plus éclatante. L’auteur y propose une étude de cas passionnante, portant sur l’importation en chinois des aventures de Tintin et sa relocalisation, en prenant en compte la variété des versions diffusées. Il montre la variété des formats et des modes de circulation, entre traductions taïwanaises, éditions pirates, éditions officielles… Tintin au Tibet s’est ainsi vu traduit à Taïwan par un pudique Tintin à la recherche de son ami, en République populaire de Chine par Tintin au Tibet chinois avant de devoir revenir au titre original, qui avait été d’emblée adopté par l’édition hong-kongaise ; de leur côté, les éditions pirates rebaptisent le récit Le Mystérieux Homme des neiges ! Norbet Danysz montre par ailleurs comment les aventures de Tintin se coulent – difficilement – dans les normes éditoriales locales : la mise en version lianhuanhua impose de redessiner quasi intégralement le récit. Au passage, Norbert Danysz propose même (malheureusement, un peu rapidement) l’idée que Tintin aurait servi d’« importateur de la BD franco-belge dans le domaine chinois » (p. 125), contribuant à importer un certain nombre de codes formels : l’intérêt d’une approche des circulations médiatiques et des transferts culturels est ici tout à fait évident.
Bien d’autres articles mériteraient de s’y arrêter. Ainsi, Deng Hao propose une contribution passionnante à l’histoire du travail du dessin, dans son article consacré au lianhuanhua pendant la Révolution culturelle : il y analyse en détail les salaires, le travail en studio, les modalités d’encadrement, les prescriptions stylistiques pesant sur les auteurs, de façon particulièrement riche. L’article portant sur la vie politique au Japon vue par Ishii Hisaichi, qui suit les remous de l’histoire japonaise, offre un éclairage inédit sur les formes de la satire politique en bande dessinée. Chu Kin-wai offre une lecture particulièrement convaincante des représentations complexes de la nostalgie dans Qu'elle était bleue ma vallée de Yeung Hok-tak, qui permet d'enrichir le corpus de romans graphiques mémoriels, et offre une lecture fine de la mobilisation de la couleur.
L’ouvrage, on le voit, est très riche, et la diversité des approches en fait tout l’intérêt. Loin d’épuiser le sujet, il offre une porte d’entrée essentielle à des travaux très riches sur la bande dessinée en Asie orientale, permet de synthétiser des courants de recherche et d’en introduire de nouveaux, dans un champ de recherche en plein essor. On regrettera qu’aucune contribution ne porte sur la Corée, ce qui ne peut que conduire à espérer que cette dynamique de recherche se prolonge.
Pour aller plus loin
Site de la maison d'édition Hémisphère, comprenant la table des matières complète de l'ouvrage.







